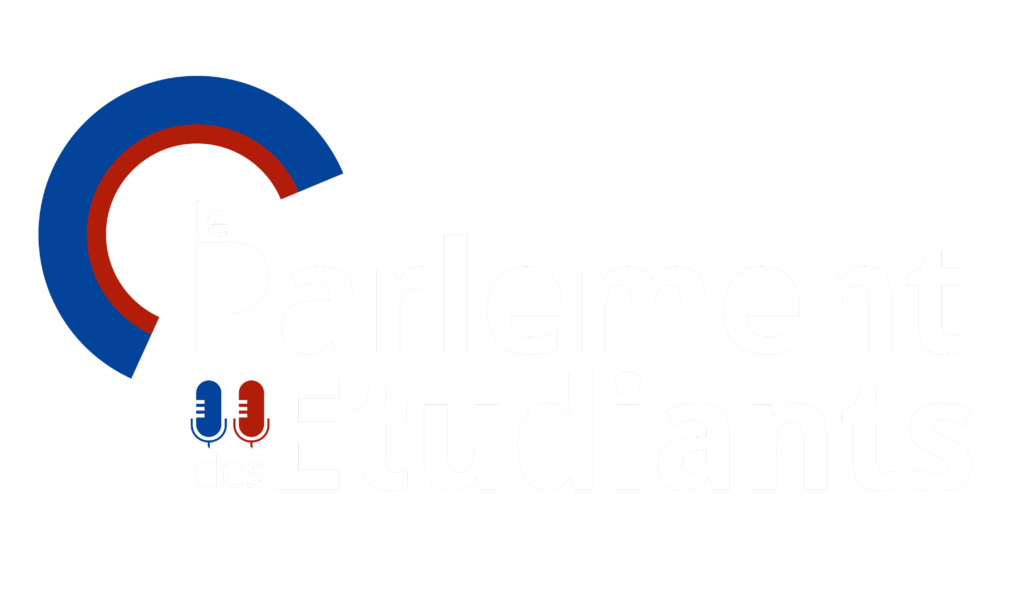Le 16 décembre 2024, le chancelier allemand Olaf Scholz, en poste depuis 2021, a perdu le vote de confiance du Bundestag, un résultat attendu après le déchirement de la coalition gouvernementale début novembre. Cette défaite a enclenché des élections législatives, qui se sont déroulées le 23 février 2025 après une campagne intense. Retour sur ces trois mois de soubresauts politiques outre-Rhin.
Un article de Solenn Michel
Un système électoral récemment réformé
En Allemagne, les élections législatives, organisées tous les quatre ans – si aucune dissolution ne vient, comme ici, déclencher d’élections législatives anticipées – permettent de désigner les députés du Bundestag, qui élisent ensuite le chancelier, chef du gouvernement. Le président jouant avant tout un rôle symbolique, ces élections déterminent la politique du pays.
Face à l’augmentation constante du nombre de députés, causée par l’ajout de nouveaux sièges pour maintenir la proportionnalité entre partis, une loi adoptée en mars 2023 a fixé un plafond à 630 sièges. Avec cette réforme, un candidat élu localement ne siège que si son parti obtient suffisamment de voix au niveau national.
En effet, le système électoral allemand est dit « proportionnel personnalisé » : chaque électeur choisit un candidat dans sa circonscription et la liste d’un parti à l’échelle nationale. La répartition des 630 sièges se fait en fonction du second vote, avec une priorité donnée aux candidats élus localement. Pour entrer au Parlement, un parti doit recueillir au moins 5 % des voix nationales ou remporter trois circonscriptions.
L’immigration au cœur de la campagne
Cette courte campagne électorale s’est déroulée dans un contexte de fortes tensions, au premier rang desquelles l’attentat du marché de Noël de Magdebourg, qui a fait 6 morts et 28 blessés le 20 décembre 2024. Le suspect, bien qu’hostile à l’immigration et proche des idées de l’extrême droite, a permis à cette dernière de développer son narratif autour de son statut de réfugié saoudien. Par la suite, en janvier et février, une attaque au couteau, puis une attaque à la voiture bélier, ont eu lieu à Aschaffenbourg et à Munich, impliquant dans les deux cas un suspect afghan. Ces évènements ont abondamment nourri le débat sur l’immigration, qui a fait partie des principaux thèmes de cette campagne.
Alternative pour l’Allemagne (AfD) est sans conteste le parti qui a le plus tiré profit de ce climat tendu. Sous la direction de l’atypique Alice Weidel, loin d’engager une stratégie de « dédiabolisation », la formation d’extrême droite a poursuivi sa radicalisation, multipliant les références plus ou moins explicites au nazisme. Son slogan de campagne, « Alice für Deutschland » (« Alice pour l’Allemagne »), rappelle celui des Sections d’assaut nazies, « Alles für Deutschland » (« Tout pour l’Allemagne »), un parallèle déjà sanctionné par la justice en mai 2024 lorsqu’un dirigeant du parti, Björn Höcke, l’avait repris mot pour mot. D’autres éléments visuels ont également suscité la polémique, comme une affiche figurant deux parents formant un toit protecteur au-dessus de leurs enfants dans un geste évoquant un salut nazi, ou encore des tracts où le visage d’Alice Weidel semble se superposer, par transparence, à la moustache emblématique d’Adolf Hitler. Ces provocations ont ravivé le débat sur une possible interdiction du parti, déjà évoquée en janvier 2024 après des révélations sur la participation de cadres de l’AfD à une réunion secrète autour d’un projet de « remigration » visant des citoyens allemands d’origine étrangère.

Malgré ces multiples appels du pied à la frange la plus radicale de l’électorat, la CDU, principal parti de droite en Allemagne, donné favori des sondages, a brisé fin janvier le « cordon sanitaire » en place depuis 70 ans dans le pays en votant avec l’AfD un texte visant à durcir la politique migratoire allemande en renvoyant systématiquement les sans-papiers à la frontière. Cette décision, qualifiée d’« erreur » par l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel – elle-même membre de la CDU –, a provoqué d’importantes manifestations dans tout le pays.
L’ombre des ingérences étrangères
De son côté, le milliardaire Elon Musk, membre du nouveau gouvernement américain de Donald Trump, a affiché son soutien sans faille à l’AfD, qu’il présente comme le seul parti capable de « sauver l’Allemagne ». Il a notamment martelé très régulièrement cette opinion sur son réseau social X via des publications sur son compte personnel et durant un entretien avec la candidate Alice Weidel, donnant à celle-ci l’occasion de brosser un portrait peu élogieux de l’Allemagne actuelle, avant d’affirmer, en réponse aux accusations qui visent son parti, « Hitler était un socialiste, un communiste ». Signe de son implication dans la campagne électorale allemande, Musk a même participé en visioconférence à un meeting de l’AfD, où il a réitéré son soutien au parti.

Cette ingérence du milliardaire dans les élections allemandes a été critiquée par le chancelier Olaf Scholz, d’autant plus que des interférences russes, notamment via les réseaux sociaux, ont aussi été signalées. En effet, la Russie investit en quantité pour favoriser les candidats « antisystème » dans plusieurs pays européens. La multiplication des fake-news est de surcroît facilitée par le développement de l’intelligence artificielle, qui pourrait devenir un enjeu crucial des campagnes électorales dans les prochaines années.
Un virage à droite et une surprise pour la gauche radicale
Comme prévu par les sondages, les résultats sont largement favorables à la droite et à l’extrême droite. La CDU arrive en tête avec 28,5 % des voix. Ce résultat, moins important que les 30 % espérés, devrait néanmoins permettre au chef du parti, Friedrich Merz, de devenir le prochain chancelier. En deuxième place avec 20,8 % des voix, l’AfD réalise une percée historique pour un parti d’extrême droite allemand depuis la Seconde Guerre mondiale. À l’inverse, le SPD, parti social-démocrate du chancelier Olaf Scholz et plus vieux parti politique d’Allemagne, réalise son pire score depuis cette période.
Un seul parti de gauche a de quoi se réjouir : Die Linke (gauche radicale) atteint la cinquième place avec 8,8 % des voix. La réaction euphorique de ses militants à l’annonce des résultats a pu surprendre dans un contexte de forte montée de l’extrême droite, mais Die Linke revient de loin : donné pour mort depuis une scission en 2023, le parti était évalué aux alentours des 3 % par la plupart des sondages durant la quasi-totalité de la campagne. La relative importance de son score final est notamment due à une forte mobilisation des jeunes, et plus particulièrement des jeunes femmes, en sa faveur. Die Linke devient ainsi le premier parti chez les 18-24 ans, devant l’AfD. Le BSW, parti né de la scission de 2023 et caractérisé par son positionnement atypique mélangeant discours social cher à la gauche et rhétorique anti-immigration et anti « wokisme », n’atteint pas les 5 %. Il échoue donc à entrer au Parlement.

Et maintenant ?
Une ère de négociations s’est ouverte après les élections, comme c’est l’usage en Allemagne. En effet, dans cette république parlementaire, il est très rare qu’un parti atteigne la majorité absolue, et les gouvernements sont donc quasi systématiquement formés par des coalitions de plusieurs partis. S’il était à peu près établi que Friedrich Merz serait le prochain chancelier, des questions subsistaient quant à la nature de la coalition gouvernementale qui l’accompagnerait.
« Notre main sera toujours tendue pour participer à un gouvernement et pour remplir la volonté du peuple. »
– Alice Weidel, 23 février 2025
Dès l’annonce des résultats, Alice Weidel a affirmé sa volonté de participer au gouvernement. Cependant, toute collaboration avec l’extrême-droite étant encore taboue pour les formations politiques traditionnelles dans le cadre d’un gouvernement national, le nouveau gouvernement allemand sera soutenu par une « grande coalition » – surnommée « GroKo » (große Koalition) en Allemagne – rassemblant les deux principaux partis historiques, soit la CDU et le SPD. Un accord a été conclu début avril, avec un programme commun élaboré au terme de négociations ardues. Ensemble, la CDU et le SPD disposent d’une majorité de 328 députés sur 630 au total, tandis que l’AfD (152 députés) devient le principal parti d’opposition.
« Le monde extérieur ne nous attend pas […]. Nous devons vite redevenir opérationnels pour [agir] sur le plan intérieur, pour redevenir présents en Europe. »
– Friedrich Merz, 23 février 2025
Merz a en tout cas tenu sa promesse de former un gouvernement « rapidement » : son élection officielle au poste de chancelier est prévue pour le 6 mai. Résolument pro-américain et atlantiste, il devra composer avec les frasques de Donald Trump, qui critique vivement l’OTAN et l’Europe et déstabilise les marchés financiers avec sa politique douanière protectionniste. La clé résiderait-elle dans un renforcement de la coopération européenne ? L’accord de coalition insiste en tout cas sur l’importance de l’Europe et sur le rôle central du couple franco-allemand dans la stabilité du continent.
Sur le plan intérieur, la priorité du gouvernement sera la relance économique. Le programme de coalition prévoit notamment un allègement fiscal pour les entreprises afin de stimuler l’investissement, ainsi qu’un vaste plan de modernisation des infrastructures et de renforcement de la défense, pour un montant total proche de 1 000 milliards d’euros. Cette rupture avec la traditionnelle prudence budgétaire allemande marque un tournant important, tant pour l’Allemagne que pour l’Europe.
Concernant l’immigration, autre sujet phare de la campagne, un compromis a été trouvé : si un durcissement des contrôles aux frontières est prévu, visant notamment l’immigration illégale, les deux partis ont aussi mis l’accent sur l’intégration, avec la création d’une « agence Work-and-Stay » pour faciliter l’emploi des étrangers sur le marché du travail. La politique migratoire ne sera donc pas aussi rigide que certains discours de campagne avaient pu le laisser entendre, les ardeurs de la CDU ayant été tempérées par le SPD, qui tente tant bien que mal de se démarquer des partis à sa droite sur ce thème.

Une chose est sûre : l’Allemagne étant à la fois le pays le plus riche et le plus peuplé de l’Union européenne, sa politique au cours des années à venir ne sera pas sans conséquence sur le reste du continent.