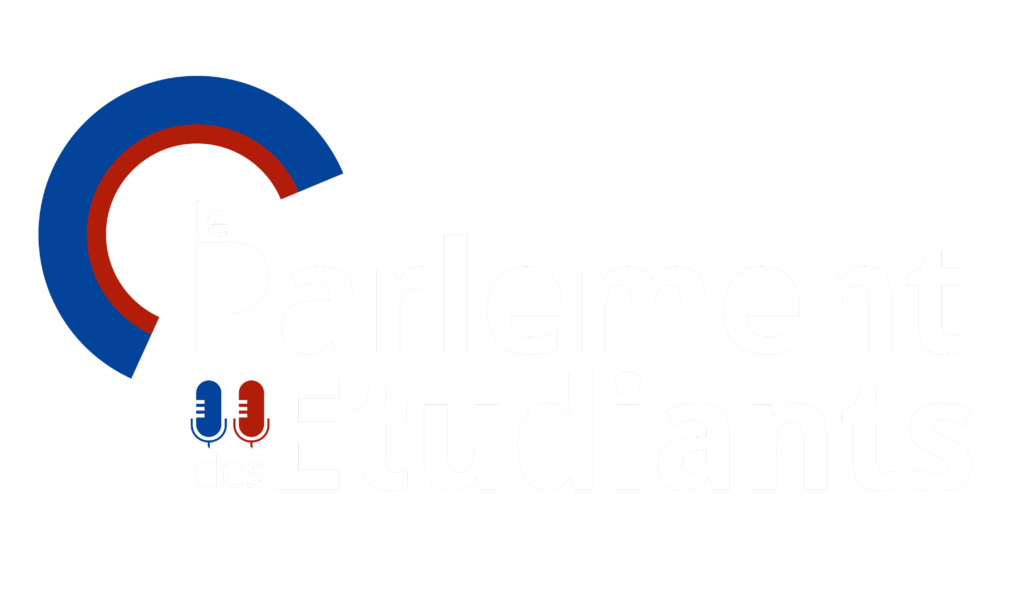Frederik Cezard
Le 11 août, Donald Trump a surpris le pays en annonçant le déploiement de la Garde nationale pour assurer l’ordre à Washington, une décision rarissime qui n’avait plus été prise sans l’accord d’un gouverneur depuis 1965. Officiellement motivée par une flambée de criminalité, cette intervention soulève pourtant de vives critiques, tant les chiffres montrent une baisse des violences dans la capitale, laissant planer le doute : maintien de l’ordre ou démonstration de force politique ?
Le 11 août, le Président américain Donald Trump a annoncé que le maintien de l’ordre dans la ville de Washington serait assuré par la Garde nationale. Cette décision a fait couler beaucoup d’encre, et à raison. Le journal Le Monde le dit bien, un tel déploiement sans l’aval du gouverneur local, d’abord en Californie puis à Washington n’était pas arrivé depuis 1965. Cette annonce est dans la continuité de la répression des manifestations contre les polices migratoires qui se sont déroulées en juin à Los Angeles. C’est ainsi que les réservistes ont été déployés à la suite de cette déclaration, puis autorisés à porter des armes, et ce depuis le 24 août. Armes qui ne peuvent être utilisées qu’en cas de danger de mort direct ou de risques de blessures graves, rappelons-le. Dorénavant, près de 2 200 soldats venus d’États sympathisants à la cause du Président comme le Mississippi ou l’Ohio arpentent la capitale étasunienne, mais quel est leur rôle ?
Trump n’a, une fois de plus, pas fait dans la finesse : il affirme que la capitale est « envahie par des gangs violents et des criminels assoiffés de sang ». Son idéologue fétiche, chef adjoint de son administration, Stephen Miller, a déclaré dans un communiqué officiel que grâce à cette reconquête de l’espace public washingtonien et en parlant des habitants : « Pour la première fois de leur vie, ils peuvent utiliser les parcs, ils peuvent marcher dans les rues. Ils peuvent marcher librement la nuit sans avoir à se soucier d’être braqués, agressés ou victimes de car-jacking. Ils portent à nouveau des montres… ». Cela doit être le prix de la liberté… Surtout quand l’on apprend que 110 de ces libérateurs ont été réquisitionnés pour ramasser les déchets dans les parcs et autres lieux de vie ! C’est le grand nettoyage avant la rentrée pour Trump. Malgré toute la bonne foi trumpiste, cette intervention n’est pas au goût de tout le monde.
En effet, la maire démocrate de Washington, Muriel Bowser dément les chiffres avancés par l’exécutif qui ont permis de légitimer ce déploiement. Le chef de la Garde se serait basé sur des comparaisons avec Bogota ou encore Mexico datant de 2024. Pourtant, les données du département du district de Columbia donnent un autre son de cloche. Après l’épidémie de Covid-19, la ville comptait 274 cas d’homicides pour 700.000 habitants, ce qui était, effectivement, le taux le plus élevé de ces 20 dernières années. Mais, au cours de l’an dernier, une baisse de 32% a été enregistrée concernant le taux d’homicides, diminution qui n’en finit plus car, depuis le 1er janvier 2025, cette baisse s’accentue encore de 12%. Plus précisément, ce sont les homicides, les vols, cambriolages et autres joyeusetés qui sont en baisse sur la période 2025 comparativement à la même période en 2024, rapporte l’Express selon des chiffres du MPDC (Metropolian Police Departemt of Columbia). Toujours selon cette source, les crimes violents sont en baisse de 26%, et les vols violents chutent de 28%. Même le ministère de la Justice américain en 2024, donc sous l’ère Biden, s’était targué d’un commentaire, affirmant que les faits de criminalité violente n’avaient jamais été aussi bas en trente ans. Il est clair que le taux de criminalité, particulièrement celui des homicides, reste haut. Il ne faut pas oublier qu’en 2023, selon la base statistique Numbeo, Washington était une des villes les plus dangereuses du pays avec 36 homicides pour 100 000 habitants, loin devant sa voisine du District de Columbia qui n’en comptait que 5,8 pour le même nombre d’habitants.
Mais les dernières statistiques publiées à ce sujet montrent bien que rien ne justifie rationnellement une telle décision et que la ville n’est ni à feu ni à sang, elle a même chuté à la dix-neuvième place du classement américain des villes les plus dangereuses. Alors, comment justifier ce qui apparaît comme une décision extrême ?
Il faut d’abord se pencher sur ce qui est en jeu ici. La Garde nationale est une force de réserve des forces armées des États-Unis, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas mobilisés à plein temps et occupent le reste du temps un emploi civil. Elle peut être mobilisée par le gouverneur de leur État d’origine, sauf dans le cas de la ville de Washington, qui, jouissant d’un statut spécial, voit la responsabilité de sa garde confiée à ni plus ni moins que le Président des Etats-Unis. Pourtant, il peut arriver qu’un Président outrepasse l’autorité du gouverneur dont il est question, prenant alors le contrôle de l’Etat visé et de sa Garde Nationale, typiquement comme ce qu’il s’est passé le 7 juin à Los Angeles.
Traditionnellement, la Garde peut être mobilisée à l’occasion de catastrophes naturelles, prêtant alors mains fortes pour les nécessités qui s’imposent dans ce genre de moments. Mais ces réservistes peuvent aussi voir leur bipper s’allumer pour les sommer de partir combattre à l’étranger, intégrant alors l’armée de métier américaine. On a ainsi pu apercevoir ces soldats en Irak ou encore en Afghanistan au sein des rangs des forces américaines. Le dernier grand déploiement de ces forces réservistes avait été demandé lors de la crise du Covid-19, où ils furent des plus utiles pour mettre en place des hôpitaux de campagne ou bien acheminer le matériel médical nécessaire. Seul le Président, comme le précise le code américain, a le pouvoir de les mobiliser pour répondre à des problématiques de sécurité intérieure, et c’est une possibilité que Trump n’a pas oublié.
Néanmoins, la Garde Nationale se doit de répondre présente dans de multiples cas comme pour repousser une invasion d’une puissance étrangère, anéantir une rébellion civile face aux autorités gouvernementales ou faire appliquer les lois fédérales si jamais les forces de sécurités régulières, malgré toutes leurs forces de persuasion, échouent. Sauf cas contraire, Washington n’est ni assiégée par les troupes canadiennes, ni mise à sac par des pillards démocrates. Pour ce qui est de l’application des lois fédérales, la cité-Etat n’est pas réputée pour sa dissidence profonde. Trump, encore une fois par l’usage excessif de ses pouvoirs en tant que résident de la Maison Blanche, campe sur des chiffres qu’il utilise à son avantage en les tronquant, montre les muscles et prouve que rien ni personne ne l’arrêtera. Il est allé jusqu’à menacer la maire de Washington d’une prise de contrôle de la ville par le pouvoir fédéral. Ainsi, le Président américain et sa garde rapprochée démontrent qu’ils sont les seuls maîtres à bord et qu’ils sont prêts, afin de le rester, de manipuler les chiffres selon leur bon vouloir..
Cette affaire met en lumière une problématique, certes bien implantée aux Etats-Unis, mais qui commence à poindre en Europe ou encore en Asie, celle de la contre-vérité. Il n’est plus question de vrai ou de faux, mais seulement d’une vérité à laquelle on choisit d’adhérer. Si ce n’est pas le cas, alors on a seulement à choisir la sienne. Trump a décidé que Washington était une ville en proie aux crimes, gangrénée par des gangs, qui à l’écouter, seraient dignes du Cartel de Medellin, et qu’il avait pour mission de la libérer, ainsi soit-il. Bien sûr, il est difficile de ne pas voir derrière cette opération une nouvelle tentative pour Donald Trump, tout d’abord de faire peur à ceux qui pourraient vouloir empêcher sa vérité de perdurer, mais aussi de renforcer son pouvoir par le biais militaire autour de ses quartiers. Le Congrès américain aura 30 jours pour se prononcer quant à la poursuite de cesopérations, mais, sachant qu’aussi bien au sein du Sénat que de la Chambre des représentants, la majorité est républicaine, la levée de camp ne devrait pas être pour demain.