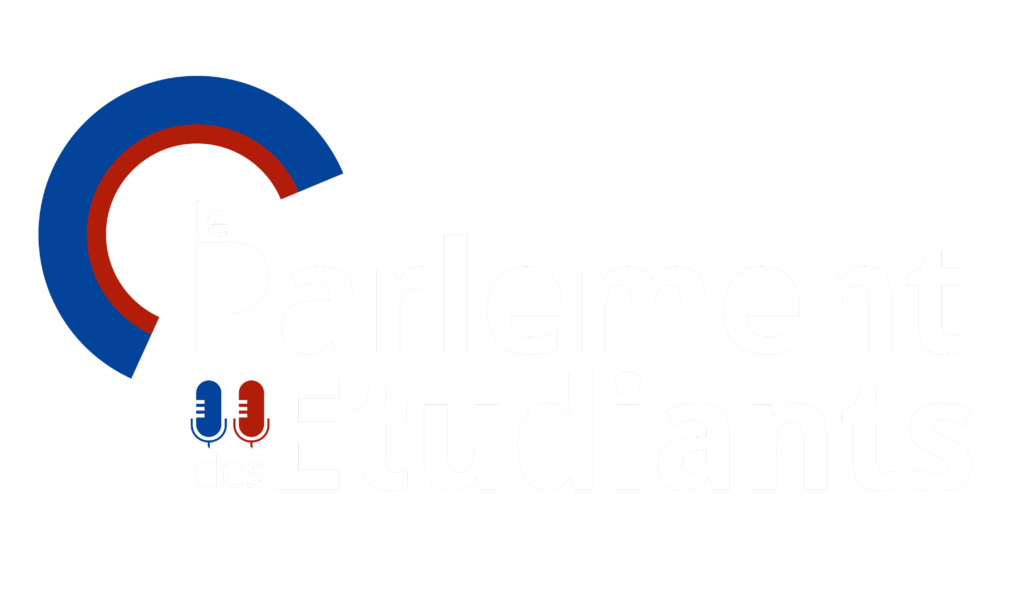Solenn Michel
C’est une nouvelle alarmante : en 2024, la France est descendue de cinq places au classement mondial de l’Indice de perception de la Corruption de l’ONG Transparency International, passant de 71/100 à 67/100. Pourtant, le sujet est peu évoqué dans les médias, et encore moins dans la classe politique, tous bords confondus.
Cette relative indifférence contraste avec l’ampleur du phénomène, dont les effets, souvent invisibles, nourrissent la défiance citoyenne et minent la démocratie. Car derrière les grandes affaires, c’est une corruption diffuse, parfois banalisée, qui prospère dans un climat d’impunité alimenté par l’inaction politique et le manque de moyens judiciaires. Comment expliquer une telle situation ? Quels leviers pour y remédier ?
Une situation alarmante sur l’ensemble du globe
L’Indice de perception de la corruption, publié chaque année par Transparency International depuis 1995, attribue à chaque pays une note de 0 à 100. Plus cette note se rapproche de 100, moins le niveau de corruption perçu dans le secteur public du pays en question est élevé.
Cet indice n’est pas conçu comme une mesure exhaustive, mais comme un thermomètre de la perception du phénomène par des experts. Treize sources de données sont mobilisées, issues d’analyses d’experts, de rapports d’institutions internationales et de cabinets de conseil spécialisés, qui prennent en compte entre autres les pots-de-vin, le détournement de fonds publics, l’efficacité des poursuites pénales ou encore la protection juridique des lanceurs d’alerte. Ces indicateurs permettent ensuite d’établir un classement mondial.
« La corruption est une menace mondiale en constante évolution qui ne se limite pas à saper le développement – elle est une cause majeure du déclin de la démocratie, de l’instabilité et des violations des droits humains. »
– François Valérian, président de Transparency International
Le faible score de la France est d’autant plus frappant quand on le compare à ceux de nos voisins : la Suisse (81), l’Allemagne (75) ou encore le Royaume-Uni (71) font mieux. Parmi les pays limitrophes, seules l’Espagne (56) et l’Italie (54) apparaissent plus bas dans le classement. Les chiffres mondiaux sont, de manière générale, alarmants : 6,8 milliards de personnes vivent dans des pays dont l’indice est inférieur à 50, soit 85 % de la population globale. La France n’en fait pas partie, mais s’invite dans le groupe des pays ayant obtenu cette année leur score le plus bas à ce jour. Elle est loin d’être la seule : ces pays représentent un quart de l’échantillon. Le problème est donc mondial, structurel et systémique.

La corruption est un sujet d’autant plus important qu’elle touche de plus en plus les fonds dédiés à la transition écologique et provoque des violences envers les défenseurs de l’environnement, ce qui compromet la confiance dans la justice climatique alors même que le changement climatique est un problème capital.
Un phénomène diffus et difficile à cerner
Mesurer la corruption s’avère particulièrement difficile, puisqu’elle est souvent dissimulée. Pour ne rien arranger, les pratiques mises en œuvre sont de plus en plus sophistiquées. Le problème est d’autant plus difficile à détecter que les effets de la corruption sont rarement perçus comme tels : qui en souffre vraiment ? et comment ? Ainsi, le manque d’accès aux soins pour les plus pauvres ou les malfaçons dans la construction de bâtiments sont rarement directement associés à la corruption, alors qu’ils peuvent en être la conséquence. Cette invisibilité favorise une forme d’inertie dans l’opinion publique.
Contrairement à d’autres pays, la France ne dispose pas d’une base de données fiable et centralisée sur le sujet, ce qui complique considérablement toute tentative d’évaluation précise. Pour mieux appréhender le phénomène, Transparency International épluche la presse locale et s’applique à réaliser une cartographie en open data des affaires de corruption sur le territoire français.
En réalité, la corruption se manifeste par des pratiques quotidiennes, parfois banalisées. On peut entre autres citer les traitements de faveur, notamment le népotisme, c’est-à-dire le fait d’user de son influence pour favoriser un proche, ou encore les rétrocommissions, accords entre une personne issue du secteur public et un acteur du secteur privé pour gonfler artificiellement les prix des produits achetés par l’État. La différence entre le prix réel et le prix facturé revient ensuite, discrètement, dans un porte-monnaie privé.
Comme souvent, certaines zones du territoire sont plus exposées à la corruption. Les atteintes à la probité sont ainsi plus nombreuses en Corse et dans les départements d’Outre-mer, où les réseaux de pouvoir locaux et le manque de contrôle renforcent la vulnérabilité aux dérives.
Une réponse politique défaillante
Face à la corruption, la France ne manque pas de discours, mais bien d’actes. Depuis les années 2010, plusieurs stratégies ont été annoncées pour renforcer l’intégrité publique. Dès 2015, un Plan national de lutte contre la corruption avait été lancé avec l’ambition de moderniser les pratiques de contrôle et de sanction. Mais très vite, il est apparu que les moyens n’étaient pas à la hauteur : le Parquet national financier (PNF), fer de lance de cette politique, ne compte qu’une vingtaine de magistrats pour traiter plus de 700 affaires. Résultat : des procédures longues, un engorgement des dossiers, et l’impression, pour certains justiciables, d’un traitement différencié selon leur statut.
À cela s’ajoute un manque manifeste de volonté politique. Après l’affaire Fillon, Emmanuel Macron avait promis une « République exemplaire », affirmant qu’un ministre mis en examen devrait immédiatement quitter le gouvernement. Pourtant, depuis 2017, pas moins de 26 ministres ou anciens ministres ont été impliqués dans des affaires politico-financières, parmi lesquels Rachida Dati, Aurore Bergé ou encore François Bayrou. Promesse non tenue ? Ces affaires alimentent en tout cas un sentiment d’impunité de la classe politique française et favorisent le discours du « tous pourris », exploité par les courants populistes.

La réponse judiciaire, quant à elle, reste lacunaire. La Cour de Justice de la République (CJR), chargée de juger les ministres pour des délits commis dans l’exercice de leurs fonctions, est critiquée pour sa composition largement politique (douze parlementaires et trois magistrats), qui interroge sur son impartialité. Aucune réforme structurelle de cette juridiction n’a été mise en œuvre, malgré des appels répétés à sa suppression ou à sa refonte.
Même les outils de la société civile sont fragilisés. En 2024, l’agrément d’Anticor, l’une des trois associations habilitées à porter plainte au nom de l’intérêt général (avec Transparency International et Sherpa), a été suspendu de façon prolongée, remettant en cause sa capacité d’action. Cet évènement intervient alors que les recommandations européennes en matière de lutte contre la corruption sont très loin d’être appliquées : en 2022, le Groupe d’États contre la corruption (GRECO) avait formulé 18 recommandations à l’attention de la France. Deux ans plus tard, seules deux d’entre elles étaient considérées comme effectivement mises en œuvre, et elles portaient sur des points mineurs. Les autres sont restées sans réponse ou ont été seulement partiellement appliquées. Le contrôle de l’exécutif, en particulier, reste un angle mort : aucune mesure sérieuse n’a été prise pour imposer la transparence des contacts avec les lobbyistes, ni pour soumettre à un contrôle préalable les nominations des conseillers de cabinet.
« Cette situation est d’autant plus inquiétante qu’elle place la France en dessous de la moyenne des pays catégorisés comme pleinement démocratiques . »
– Transparency International
Quelques progrès ont certes été enregistrés, notamment avec la loi Sapin II, votée en 2016. Ce texte a instauré un cadre pour mieux prévenir les conflits d’intérêts, améliorer la protection des lanceurs d’alerte et renforcer la responsabilité des entreprises. Il a aussi permis la création de l’Agence française anticorruption (AFA), qui coordonne les actions de prévention et de contrôle. Mais là encore, les failles demeurent : trop souvent, les responsables publics quittent leurs fonctions pour rejoindre le privé, avec des carnets d’adresses bien remplis et une connaissance fine des rouages de l’État. Ce problème n’est cependant pas exclusif à la France : de 2017 à 2023, au Royaume-Uni, plus de 170 anciens ministres ont accepté des postes dans des secteurs directement liés à leurs précédentes responsabilités.
Un défi démocratique
L’un des défis majeurs reste l’éducation du public : un travail de pédagogie est nécessaire pour faire lui comprendre que la corruption ne relève pas uniquement des « affaires » de la haute sphère : elle concerne l’argent public, et donc chaque citoyen. Aujourd’hui, seuls 26 % des Français déclarent avoir confiance dans la politique. Or, la corruption en est l’une des causes majeures, car elle sape les fondements mêmes de la démocratie : égalité devant la loi, intégrité des représentants, confiance dans les institutions… Pourtant, le sujet a été quasiment absent des élections européennes de 2024, comme il l’est, plus largement, du débat public. Dans le même temps, les conséquences d’une corruption mal combattue sont visibles, et la défiance envers le personnel politique atteint des sommets.

D’après Transparency International, trois dynamiques principales expliquent cette fracture croissante entre les citoyens et leurs représentants : d’une part, les scandales à répétition, des attachés parlementaires, du Rassemblement national à l’affaire Bygmalion, en passant par les procès de Nicolas Sarkozy, ont entaché durablement la crédibilité des élites politiques ; d’autre part, le non-respect des engagements présidentiels, notamment sur la promesse de limoger les ministres mis en examen, a alimenté une impression de duplicité ; enfin, l’instabilité politique, nourrie par des tractations opaques, des manœuvres partisanes et une mise à mal des règles, renforcent cette méfiance généralisée.
Cette perte de confiance s’aggrave encore dans un contexte de crises multiples. La lutte contre le narcotrafic met en lumière les risques croissants de pénétration de la criminalité organisée dans la sphère publique, et le scandale Nestlé-Waters a souligné les failles de la régulation environnementale. Ajoutons à cela un climat économique incertain, marqué par un manque de prévisibilité de l’action publique, et l’influence croissante des intérêts privés sur l’État, comme le montre le poids croissant des cabinets de conseil (McKinsey en tête) et des lobbies.
Quel avenir pour la lutte anticorruption ?
Mais évitons de sombrer dans un catastrophisme absolu : toutes les décisions politiques ne sont pas dictées par la corruption. L’essentiel est de comprendre les logiques à l’œuvre, notamment à travers la théorie du principal-agent : le « principal » (le citoyen) délègue un pouvoir de décision à un « agent » (le représentant politique), mais celui-ci peut avoir des intérêts divergents et utiliser son pouvoir à d’autres fins que celles prévues. Ce décalage ne résulte pas nécessairement d’une volonté malveillante, mais d’un manque de contrôle et de mécanismes de reddition de comptes.
La lutte contre la corruption ne peut pas avoir pour but de l’éradiquer totalement, ce qui serait irréaliste, mais de la gérer et de permettre aux citoyens de tout de même vivre dignement.
Par-dessus tout, les recommandations de Transparency International offrent une feuille de route crédible. Parmi elles, le renforcement des moyens du Parquet national financier, une meilleure indépendance de ce parquet vis-à-vis de l’exécutif, la transparence accrue des relations entre responsables publics et lobbies ou encore un Plan national pluriannuel de lutte contre la corruption « à la hauteur des enjeux ».
« La France risque de perdre le contrôle de la corruption. »
– Transparency International
La situation française, certes, n’est pas la pire du monde. Mais elle est en détérioration progressive, et mérite une attention sérieuse. Une enquête Harris Interactive de 2023 montre que 87 % des Français estiment que les personnes exerçant des responsabilités sont corrompues, un chiffre en légère baisse par rapport aux années 2016, 2017 et 2019, mais qui reste révélateur d’une crise de confiance majeure. Quant aux condamnations judiciaires des responsables politiques, les avis sont partagés : un quart des sondés les jugent plus sévères qu’auparavant, un autre quart les considère comme plus clémentes, et la moitié estime qu’elles sont inchangées. En revanche, une majorité nette (61 %) considère que les règles de transparence pour les responsables politiques ne sont pas assez strictes.
Reste à savoir si les institutions auront le courage de réagir… et si les citoyens seront suffisamment informés et mobilisés pour l’exiger.
Solenn Michel